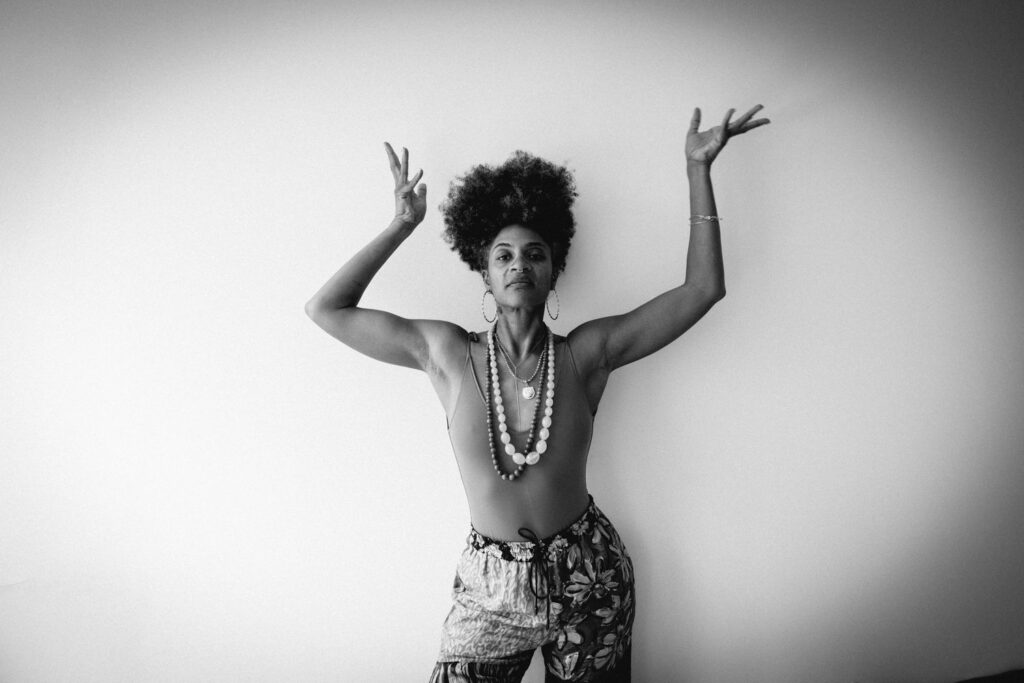L’une est une ex-championne de football qui œuvre pour encourager les enfants à pratiquer le sport de manière égalitaire, et à lutter contre les stéréotypes qui freinent l’égalité filles-garçons. L’autre est une jeune sociologue nantaise. Toutes deux font le constat amer que les inégalités de genre persistent dans le monde du sport. Entretien avec Nicole Abar et Amélie Pouillaude.
Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots à votre sujet ?
Amélie Pouillaude : Originaire de la Vendée, je suis devenue sociologue après avoir suivi une licence et un master STAPS et mené une thèse en sociologie du sport à l’Université de Lille. Mes travaux ont porté sur la socialisation et l’évaluation des corps dans les sports artistiques, comme la gymnastique rythmique et le twirling bâton. Je suis également enseignante à l’université de Nantes, au sein de l’UFR STAPS.
Nicole Abar : Native de Toulouse, je suis ancienne joueuse de football (des années 70 à 90). J’ai joué dix ans en équipe de France, je compte huit titres de championne de France, ainsi que celui de meilleure buteuse en 1983. Depuis 2003, j’ai un diplôme d’entraineuse de football, dans la promotion de Didier Deschamps. Le football n’était pas ma vocation, ce sport m’a choisie et m’a aidée à comprendre que j’avais de la valeur. Puis, j’ai créé l’association Liberté aux joueuses en 1996 et cofondé le collectif Égal Sport, né voilà 5 ans, qui a pour but de promouvoir et soutenir la place des femmes dans le sport et de dénoncer toutes les formes de discrimination. Notre prochain combat : créer un Mooc sur les stéréotypes dans le sport ; il verra le jour à horizon 2025. Aujourd’hui, je travaille à la création d’un deuxième documentaire (après le film “La conquête de l’espace” sorti en 2023, ndlr). Il pourrait être présenté en novembre prochain avec l’objectif de sensibiliser et mobiliser l’opinion publique sur la mise en mouvement des enfants et les stéréotypes véhiculés depuis leur plus jeune âge.
Nicole, vous êtes investie pour l’égalité femmes-hommes. Comment est né cet engagement ?
Nicole Abar : Je suis née en 1959, fille d’un père algérien et d’une mère italienne. J’ai été victime de racisme et ai longtemps vécu ces regards méprisants et dévalorisants. J’avais plutôt une personnalité effacée et discrète mais, un jour, j’ai pris la parole. C’était en 1998. Le club de foot du Plessis-Robinson a alors décidé de dissoudre sa section féminine, car les joueuses, qui avaient deux niveaux au-dessus de l’équipe masculine, demandaient à monter en D2. Une décision discriminatoire qui n’est pas passée. Nous avons alors décidé d’attaquer le club en justice pour discrimination sexiste. Nous avons gagné cinq ans après.
D’autres exemples de discrimination ? La lumière du stade s’éteignait même si les joueuses n’avaient pas fini l’entraînement, nous n’avions pas les mêmes moyens, pas d’équipements, pas de primes… Mais c’était le prix à payer pour jouer.
Et vous, Amélie, pourquoi vous êtes-vous intéressée à la place des femmes dans le sport ?
Amélie Pouillaude : À l’âge de 6 ans, j’ai commencé le twirling bâton, un sport très féminisé (environ 10% d’hommes). On pourrait se dire que la place des femmes y est acquise, pour autant, leurs corps sont très contrôlés. J’ai pu constater un jugement qui pèse sur leur apparence physique. En découlent des problèmes de confiance en soi, des troubles de l’alimentation, voire des cas d’anorexie. J’ai pu moi-même prendre de la distance avec ces jugements normatifs grâce à mon cursus STAPS où la sociologie était très présente et les femmes peu nombreuses. Finalement, peu de personnes parlent de ces problématiques.
Nicole Abar : Ce sont tout un tas de petites discriminations sexistes qui, cumulées, font que l’on vous met un handicap, que l’on vous enferme.
Nicole, l’année dernière, vous avez réalisé une nouvelle version du documentaire “Passe la balle”, 20 ans après le premier projet. Que s’est-il passé en 20 ans ?
Nicole Abar : Certes, le cadre juridique a évolué avec 45 textes de loi mais, au fond, rien n’a changé ! Les images sont toujours les mêmes. Pour les filles comme pour les garçons, c’est toujours l’homme qui conduit et la femme qui fait la vaisselle. Si évolutions il y a, elles se font sous la contrainte (loi sur la parité, loi-cadre sur l’égalité femmes-hommes, avec un volet consacré au sport). Pour que les lignes bougent réellement, il faut aller à la racine pour faire changer cette vision sexuée du sport.
Amélie, de votre côté, observez-vous des évolutions ?
Amélie Pouillaude : Je partage son constat, même s’il faut souligner une féminisation de certaines instances. En 2016, 87 fédérations sportives ont mis en place des plans de féminisation, contre 4 en 2006, selon le rapport publié en 2023 par Marie Carmen Garcia et Cécile Ottogalli Mazzacavallo sur la pratique sportive des femmes. On peut noter une nette progression sur les sports collectifs et individuels, de combat et athlétiques. Mais, malgré ces initiatives politiques, il est difficile de casser les stéréotypes de genre. Les raisons de la persistance de ces différences ? Elles tiennent de la socialisation des filles et des garçons. Il y a un gros travail à faire pour que les filles et les femmes puissent – et se sentent autorisées à – prendre le pouvoir.
Comment agir justement ?
Nicole Abar : Il faut travailler dès le plus jeune âge sur les stéréotypes, entretenir le discours que les petites filles peuvent aller dans tous les sports et former, en ce sens, tous les adultes (personnels enseignants, municipaux, sportifs…) qui sont au contact avec les enfants.
Amélie Pouillaude : Par effet de miroir, il faut aussi dire que les garçons peuvent aller vers les pratiques les plus connotées comme féminines. Je pense notamment à la gymnastique rythmique où il y a seulement 1% de pratiquants au niveau fédéral. Les garçons ne sont pas autorisés au niveau élite ni aux championnats internationaux. C’est aberrant ! Dans un autre registre, il faut aussi développer la pratique sportive pour les filles dans les ruralités parce que les activités qui leur sont proposées sont encore peu nombreuses ou très genrées.
Malgré les progrès réalisés dans le sport féminin professionnel, des défis importants subsistent. Lesquels selon vous ?
Amélie Pouillaude : Dans le sport à haut niveau, il y a des inégalités en matière d’équipements et d’égalité salariale. Concernant la prise en compte de la maternité et la protection des jeunes mamans, il y a également un vide juridique même si la Fédération Française de Football commence, je crois, à se pencher sur la question, et que la Fédération Française de Handball s’en préoccupe. Autre sujet : la question du port du voile qui divise. En effet, la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a interdit aux sportives sélectionnées en équipe de France de porter le voile aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que le CIO (Comité international olympique, ndlr) l’a autorisé. Développer la pratique des femmes c’est aussi prendre en compte la diversité de leurs réalités sociales.
Autre sujet dont il faut s’emparer et qui me tient à cœur : la surveillance du poids dans les sports artistiques à haut niveau. Dans ces disciplines, les codes concernant l’apparence sont encore très figés : pour être jugée belle, il faut être très mince. Dans la gymnastique rythmique, les pratiques alimentaires sont catastrophiques et ce, jusqu’à surveiller les apports hydriques. Sans parler des dégâts psychologiques (menstruations retardées, ossature fragilisée…). Ce qui pose des questions d’ordre éthique. On assiste à de la casse d’athlètes.
Et quid de la visibilité ? Les médias jouent-ils un rôle dans la pérennisation de ces inégalités, en accordant souvent une couverture médiatique insuffisante aux événements sportifs féminins par rapport à leurs homologues masculins ?
Amélie Pouillaude : On s’occupe davantage des intérêts financiers que de développer le sport des femmes. Or, les médias devraient impulser cette dynamique en diffusant davantage d’événements sportifs féminins. Il faut également noter qu’il y a une perpétuation des stéréotypes de genre par certains commentateurs. C’est choquant ! Il faut mieux former les journalistes. Une plus grande visibilité du sport féminin aura le potentiel d’inspirer les générations futures. Mais une plus grande médiatisation doit être couplée à l’éducation des hommes et des femmes aux questions de genre pour changer la vision du sport des femmes en profondeur.
Nicole Abar : Les femmes journalistes de sport doivent prendre une vraie place et ne pas oublier qu’elles ont un devoir citoyen de mettre en valeur les femmes et le sport féminin pour être un rôle modèle.
En 1900, les femmes prenaient part aux Jeux Olympiques pour la première fois. Elles étaient 22 (pour 975 athlètes hommes). En 2024, elles seront 5 250, 50% des athlètes, la parité absolue pour la première fois dans l’histoire des Jeux entre les athlètes femmes et hommes. Les JO de cette année sont présentés comme une avancée majeure. Le signe d’un véritable engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes ou une simple stratégie de communication ?
Amélie Pouillaude : Pour moi c’est une avancée, mais c’est la partie émergée de l’iceberg. La mixité est-elle réellement présente au sein des disciplines ? Certaines sont encore, soit réservées aux hommes (lutte gréco-romaine), soit aux femmes (gymnastique rythmique). Certes, c’est symbolique mais il faut engager un traitement de fond pour tendre vers l’égalité dans le sport.
Nicole Abar : C’est un affichage. Je pense aujourd’hui à Alice Milliat (qui était une pionnière du sport féminin mondial et a permis aux femmes leur participation à l’épreuve d’athlétisme aux Jeux Olympiques, ndlr). Si son action et son héritage peuvent nous servir à donner un aspect plus emblématique à ces JO, alors, je la remercie.
Propos recueillis par Florence FALVY