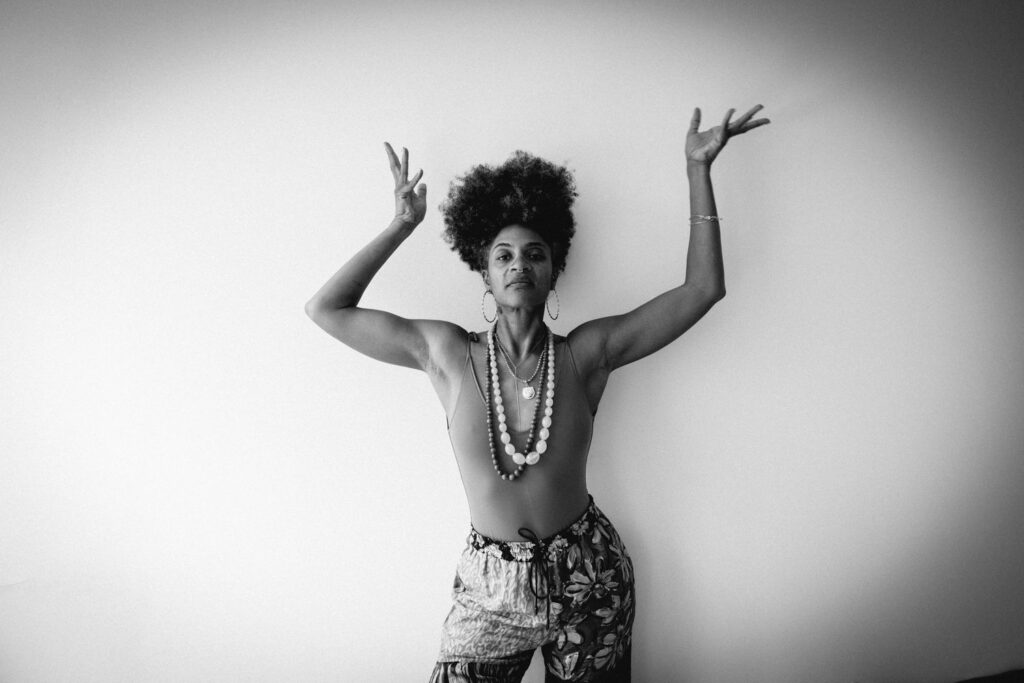Pourquoi est-ce important de continuer à transmettre autour des enjeux féministes ? Est-ce que tout n’a pas déjà été documenté sur le sujet ? Ou comment contrer le backlash en cours ? Fiona Schmidt, autrice (Vieille peau, Lâchez-nous l’utérus, L’Amour après #MeToo) et militante féministe, passe une grande partie de son temps à partager et vulgariser des informations sur son compte Instagram. Tandis que Lucile Devulder œuvre en tant que cheffe de projet à la création d’un musée des Féminismes à Angers. Deux générations de féministes et deux manières de transmettre sur le féminisme – en féministe – que nous avons fait dialoguer.
Pourriez-vous chacune vous présenter et nous dire ce qui vous a ouvert les yeux sur les enjeux féministes ?
Fiona Schmidt : Je me définis comme essayiste et militante féministe. Avant, j’ai été journaliste et ai travaillé dans la presse féminine, pour Cosmopolitan, puis Be et Grazia. Je me suis politisée tardivement. Pendant très longtemps, j’ai été aveugle aux inégalités de genre, parce que je suis privilégiée : je suis blanche, hétérosexuelle, je viens d’un milieu social avantagé, j’ai un bagage culturel… J’ai ouvert les yeux à la faveur d’un événement personnel, lors de la mort de ma grand-mère en 2015. J’ai compris que même si ma famille venait d’un milieu privilégié, les violences de genre n’avaient pas épargné les femmes de ma famille et s’étaient transmises de génération en génération, dans l’omerta la plus totale. Cet événement a coïncidé avec la lecture du livre Bad Feminist, de Roxane Gay, qui m’a rassurée : être féministe n’exigeait pas de moi que je sois omnisciente, ni parfaite, c’est un engagement du quotidien.
Lucile Devulder : Je suis cheffe de projet de l’AFéMuse depuis janvier 2025. L’association œuvre à la création d’un musée consacré à l’histoire des mouvements féministes, le premier en France. C’est un poste que je viens d’obtenir, après avoir étudié les relations internationales à Sciences Po et la gestion du patrimoine culturel à l’Université Panthéon-Sorbonne. Je me reconnais donc plutôt dans le milieu privilégié que tu évoquais, Fiona. Ce qui fait que j’ai aussi longtemps été aveugle aux inégalités de genre. Puis #MeToo est arrivé, j’avais 18 ans, et cela a beaucoup joué dans mon éducation aux enjeux féministes. Mais je ne peux pas dire que je travaille en tant que « militante féministe ». Car les musées conservent un caractère non partisan et doivent s’appuyer sur une légitimité historique, scientifique, académique.
Qu’est-ce qui a déclenché chez vous le désir de transmettre autour du féminisme ?
Fiona Schmidt : J’ai commencé à partager mes réflexions naissantes sur mon compte Instagram parce que cette plateforme me semblait idéale pour partager mes réflexions naissantes. Elle est moins figée qu’un média plus traditionnel. On peut y communiquer directement avec les gens. J’ai donc remplacé mes photos de cappuccinos et de mon chat par mes questions féministes. Et j’ai beaucoup appris sur cette plateforme moi aussi. Cela m’a permis d’aller plus loin, de me tourner aussi vers des livres et des documentaires. Et, en retour, de vulgariser certaines pensées pour les rendre accessibles au plus grand nombre.
Lucile Devulder : Je rejoins Fiona dans cette idée de rendre l’information accessible au plus grand nombre. C’est ce qui m’a donné envie de travailler dans l’univers des musées. Je me suis demandée comment je pouvais contribuer au changement et, pour moi, ma voix était associée au secteur de la culture.
On a l’impression qu’on n’a jamais été aussi bien informé·es sur les inégalités qu’aujourd’hui. Il y a déjà pléthores d’ouvrages, de podcasts, de statistiques… Pourquoi la transmission sur ces enjeux est-elle toujours importante selon vous ?
Lucile Devulder : C’est vrai qu’il y a de plus en plus de savoirs sur le sujet, mais l’histoire des féminismes reste en même temps très peu ou très mal connue. Or c’est important de connaître toutes les luttes qui nous ont précédées, pour savoir d’où l’on vient et pourquoi on en est là.
Fiona Schmidt : J’ajouterais que l’augmentation du volume de données disponibles sur le sujet du féminisme s’est hélas accompagnée d’un backlash de la part des conservateurs et conservatrices. Cela m’apparaît donc d’autant plus important de continuer à informer et à militer sur les réseaux sociaux, qui sont des plateformes ouvertes à tout le monde.
En quoi transmettre sur les cimaises d’un musée et transmettre sur les réseaux sociaux peut-il se rapprocher ou, au contraire, jouer sur des tableaux différents ?
Lucile Devulder : C’est plutôt complémentaire. D’ailleurs, les musées travaillent de plus en plus avec des influenceurs ou des influenceuses, pour toucher différents publics. Je dirais en tout cas que l’essence d’un musée consiste à transmettre aux générations futures. Avec le musée des Féminismes, nous cherchons à inscrire l’histoire des féminismes dans notre héritage commun.
Fiona Schmidt : Transmettre sur un réseau social comme Instagram, c’est vraiment un moyen pour moi de rendre accessible des réflexions. Même si je suis aussi consciente que cette transmission est contrainte par un algorithme, défini lui-même par des conservateurs. Cela peut parfois donner l’impression de ne toucher que des personnes convaincues comme moi, mais il faut continuer à faire tout un travail de pédagogie, pour ne pas dissuader des personnes de rejoindre nos combats.
Lucile Devulder : Du côté des musées aussi, les gens qui viennent voir des expositions sont convaincus le plus souvent. Mais il y a aussi tout un travail de médiation qui peut être enclenché à partir de cet espace : nous allons directement chercher certains publics qui ne seraient pas venus de leur plein gré. Et l’avantage d’une exposition, c’est qu’elle peut rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes, soit bien plus qu’un article scientifique ou un livre.
Est-ce que vous diriez que le musée va plus vers la transmission de l’histoire et de la mémoire, tandis que les réseaux sociaux permettent une transmission en réaction à l’actualité ?
Fiona Schmidt : L’actualité, c’est déjà l’histoire de demain !
Lucile Devulder : Oui, d’autant qu’il y a aussi des influenceuses autour de l’histoire. Surtout, je dirais que le musée qu’on essaye de construire à Angers sera un peu hybride. Certes, il s’agira d’un musée d’histoire, mais aussi de société. Nous aurons également des objets contemporains. En 2023-2024, nous avons par exemple organisé une collecte de pancartes, tee-shirts et autres accessoires de manifestation. Et on y retrouvait d’ailleurs plein de références à l’histoire ! Cela a donné lieu à notre première exposition, « Les femmes sont dans la rue ! », qui retraçait les mobilisations des femmes de la Révolution jusqu’à nos jours.
Lucile, le musée des Féminismes abordera-t-il le sujet d’âgisme, c’est-à-dire celui des inégalités des femmes par rapport aux hommes ? C’est un sujet qui commence à prendre de l’ampleur dans les discussions féministes, que Fiona a justement documenté dans « Vieille peau ».
Lucie Devulder : Ce n’est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas, on pourrait l’imaginer ! Car le musée veut documenter l’histoire des luttes et de l’émancipation des femmes dans tous les domaines de la société. Il y a des centaines de choses à faire !
Et comment faites-vous, toutes les deux, pour garder le moral face aux backlash féministe, que vous décriviez tout à l’heure ?
Fiona Schmidt : En buvant du Vouvray ! (rires) Plus sérieusement, j’essaye de me rappeler pourquoi je m’investis sur ce sujet et l’importance de militer. Et si je m’investis, c’est aussi parce que j’y crois qu’un changement collectif est possible. Être féministe implique d’être optimiste. Sinon je ferais du yoga et je tenterais juste de doper mon propre bien-être… Et surtout, je pense que s’il y a un backlash, c’est justement parce que nos idées sont de plus en plus présentes dans la société.
Lucile Devulder : Je suis d’accord avec Fiona. Je pense que le backlash est aussi la conséquence de toute cette vague violette inédite qui déferle. Et ça donne aussi de l’espoir !
Rédaction : Mathilde Doiezie