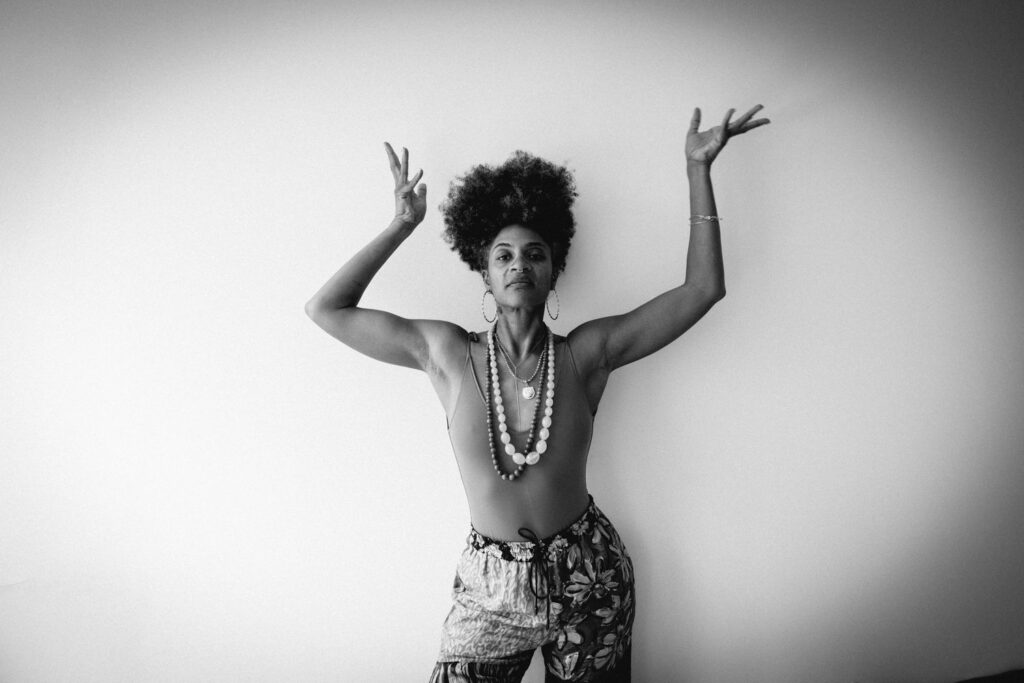Marie Carroget est vigneronne au Domaine de la Paonnerie, à Anetz (44), et a cofondé avec sa compagne Elodie Louchez le salon « Canons », dédié aux vigneronnes produisant des vins naturels. Laura Guillemot est maraîchère à Nantes sur son exploitation de la ferme du Bois des Anses. Toutes trois ont accepté de se prêter au jeu de l’interview croisée pour laquelle elles ont échangé avec conviction et passion sur leurs quotidiens, leurs féminismes, leurs engagements.
Pour commencer, quelques mots à votre sujet. Pouvez-vous vous présenter ?
Elodie Louchez : Je suis journaliste, je m’occupe du média Les champs d’ici tout en continuant à travailler sur des projets documentaires. J’ai rencontré Marie quand elle était brocanteuse, nous venions régulièrement dans le domaine de ses parents jusqu’à ce que l’on prenne la décision de venir s’installer ici définitivement. Ce fut alors comme si nous avions appris à nous reconnecter avec tout : la biodiversité, les humain·es… On s’est rendu compte qu’on évoluait dans un milieu qui avait une grande marge de progression sur l’égalité des genres. C’est pour cela que nous avons lancé le salon Canons il y a 6 ans, pour visibiliser les vigneronnes qui produisent des vins naturels, en proposant un rendez-vous joyeux ! Nous avons commencé avec 15 vigneronnes et lors de notre dernière édition, elles étaient 42. Canons est la métaphore d’un actuel élan des femmes dans le vivant.
Marie Carroget : Je suis vigneronne à l’année sur huit hectares de vignes en bio, sans intrant [un intrant est un produit apporté aux terres et aux cultures, qui n’est pas naturellement présent dans le sol]. Je fais un métier assez solitaire mais pour autant j’aime travailler en collectif et partager. Je fais donc partie d’un certain nombre de collectifs : le salon Canons mais aussi Viti-F, un collectif de femmes du vin que j’ai participé à créer cette année.
Laura Guillemot : Je suis maraîchère à la Ferme du Bois des Anses depuis fin 2020, en maraîchage bio avec beaucoup de plantes aromatiques. J’ai repris une ancienne ferme maraîchère inexploitée depuis plus de 10 ans. Je suis aux portes de Nantes ce qui me permet d’avoir une clientèle de proximité. Je travaille sur un hectare de maraîchage et 1700 m2 de serres. Je suis fille d’éleveurs de chèvres et pour moi, faire pousser des légumes n’avait du sens que si c’était bien fait ! Je défends le respect de l’environnement et pour cela, je fais beaucoup de pédagogie avec les client·es. Je suis en label bio mais mes produits vont bien au-delà de cela car je n’utilise aucun traitement ni produit. L’idée est de créer un espace avec beaucoup de vie et de continuer à aller dans ce sens pour que les choses se régulent elles-mêmes. Toute ma production est vendue en circuit court, car je vends à la ferme le mercredi et le reste de la production est destiné à une sélection de restaurants nantais. Ce travail est une reconversion, je travaillais avant dans le monde du spectacle et aujourd’hui, j’ai envie de faire de la ferme un lieu qui puisse aussi vivre par d’autres activités. Mais c’est un équilibre à trouver car je manque de temps pour réaliser toutes mes envies !
Vous définissez-vous comme féministes ?
Elodie : Oui c’est une évidence ! Il y a un prolongement naturel et de sens entre le féminisme et le vivant. Il faut « faire place » et cela s’exprime pour moi, par mon engagement féministe.
Marie : Je suis féministe parce que j’ai envie de pouvoir dire ce que je pense et d’être dans un monde égalitaire. Mais je constate, depuis que nous avons créé le collectif Viti-F, que beaucoup de femmes, notamment des vigneronnes, avaient peur de se dire féministes, peur du terme en lui-même. Je n’ai pas peur de me dire féministe mais je trouve qu’il est intéressant de l’articuler car nous avons chacune notre propre féminisme.
Laura : Je comprends ce que tu dis car je ne me proclame pas comme féministe mais je pense que je le suis par mes actions et mes engagements. Je ne me sens pas militante mais je mène un travail qui prône des valeurs féministes, notamment en répondant par exemple aux sollicitations de jeunes femmes qui veulent faire un stage à la ferme. Je pense que mon engagement se fait au quotidien, en posant des briques jour après jour depuis mon installation.
Elodie : Quand on a commencé à travailler avec Viti-F, les points de réflexions féministes se sont surtout cristallisés autour des outils agricoles, créés par des hommes, pour des hommes. Laura et Marie, vous êtes dans la branche « haute » de la pénibilité au travail et je pense que l’expression d’un engagement féministe s’exprime notamment dans la faculté des femmes, des exploitantes agricoles à réinventer leurs outils de travail.
Laura : À mon installation, j’aurais aimé qu’il y ait des formations comme celles dédiées aux femmes que propose aujourd’hui le CIVAM. Je vois une grande différence en quatre ans, il y a beaucoup moins de remarques sexistes qu’à mes débuts. Je trouve que l’on est plus considérées, même vis-à-vis des banques. Des choses se mettent en place pour nous redonner confiance et nous faire évoluer dans un climat de bienveillance.
Laura, vous avez dit dans une précédente interview, en parlant de votre installation : « Être une femme est une difficulté supplémentaire. Il faut toujours prouver un peu plus ». Qu’entendez-vous par là ? Et vous Marie, êtes-vous d’accord avec ce qu’exprime Laura ?
Laura : À mon installation, j’ai dû faire face à des à priori que l’on me renvoyait sur ma condition, sur le fait que j’évoluais dans un métier physique. J’ai eu le sentiment que j’avais doublement à prouver. Cela m’a mis une pression supplémentaire par rapport à mes collègues masculins.
Marie : J’ai une aversion pour le tracteur car cela me donne l’impression de prendre les vignes de haut ! J’ai donc décidé d’arrêter de travailler le sol, et en faisant ce choix, j’ai cherché à avoir des réponses aux questions que je me posais, notamment « Pourquoi on travaille le sol ainsi ? ». J’ai eu doublement à prouver, moi aussi, parce que la seule réponse que je recevais était « Parce que c’est ainsi qu’il faut faire » ! Pendant 3 ans, on m’a répondu ça, je suis entrée en conflit immédiatement car je faisais différemment (rires) ! Finalement, j’ai fini par avoir des réponses : on travaille les sols pour les oxyder, pour avoir plus de rendement… Mais aujourd’hui, je vois que ma façon de faire différemment commence à faire réfléchir autour de moi.
Depuis 2020, on assiste à un « MeToo du vin » avec des témoignages sur des agressions sexuelles dans le monde du vin émanant de vigneronnes, de cavistes, de sommelières, d’œnologues relayés notamment par l’association Paye ton pinard. Faites-vous partie de ce mouvement ?
Elodie : Je fais moi-même partie de l’association Paye ton pinard et le fait d’organiser le salon Canons était aussi un moyen de recueillir la parole des femmes. Dans le milieu du vin, l’alcool peut conduire à des pratiques complexes, des pratiques paysannes qui amènent certains vignerons à se sentir au-dessus des lois. Je souhaite rester du côté positif, en générant des événements qui visibilisent les femmes, pour montrer leur travail, pour les rendre invincibles face à des pratiques de primates non éduqués. On entend les témoignages des vigneronnes mais il y a aussi beaucoup de sommelières et d’œnologues qui subissent ces attaques sexistes. Nous sommes au début d’un changement, je pense que le milieu du vivant a décidé d’être plus ouvert. Même si ce changement prend du temps et qu’il est difficile, je suis heureuse d’accompagner ces démarches.
Marie : Depuis toute petite, avec ma sœur, nous avons pris l’habitude d’envoyer promener les hommes qui venaient à la cave de nos parents et nous faisaient des remarques. Quand j’en parle avec ma mère qui faisait du vin nature dans les années 2000, elle me dit: « Je me renfermais pour me protéger ». Depuis toujours je sais donc qu’il existe ce côté orgiaque inhérent au vin nature. Je ne suis pas surprise d’entendre les témoignages de femmes victimes car je suis née dans ce milieu mais cela ne veut surtout pas dire que c’est normal ! Il faut faire changer les choses, en parler.
Laura : Pour ma part, dans le maraîchage, je n’ai pas l’impression qu’il y ait autant de problèmes que dans le vin car nous n’avons pas le mauvais côté de l’alcool, de la fête. Bien sûr j’ai subi des remarques machistes mais cela n’a jamais été jusqu’au point d’être dangereux.
Vous sentez-vous une responsabilité en tant que femmes exploitantes agricoles ?
Marie : Pour reprendre ce que disait Laura, c’est important de prendre des stagiaires femmes, c’est une bonne base de pouvoir donner confiance à une femme qui souhaite s’installer.
Laura : Je suis ravie d’avoir pu suivre l’évolution d’une stagiaire que j’ai connue lorsqu’elle était à Pôle Emploi et de la voir aujourd’hui installée sur son exploitation, après avoir fait un stage avec moi. C’est très gratifiant.
Élodie, vous parliez d’un « élan des femmes dans le vivant ». Qu’entendez-vous par là ?
Elodie : Même s’il existe encore trop peu de données chiffrées, les études montrent que les femmes qui s’installent dans l’agriculture le font plus en bio qu’en exploitation conventionnelle. Elles cherchent à s’installer à une plus petite échelle, avec une approche différente.
Auriez-vous des conseils à donner à celles qui veulent elles aussi, se lancer à la tête de leur exploitation agricole ?
Marie : Il faut se lancer, il faut faire ! Évidemment, il ne faut pas s’imaginer que cela sera facile, tout est compliqué : la MSA [Mutualité sociale agricole], travailler avec le vivant… Mais pour autant, le quotidien est génial, je ne regrette rien.
Laura : L’installation est toujours compliquée mais il faut savoir bien s’entourer. Il existe un fort réseau d’aide dans notre région : le GAB [Groupement des agriculteurs bio], le Cap 44…. Il faut profiter de tout ce qui est mis en place pour nous accompagner.
Rédaction : Solenn Cosotti