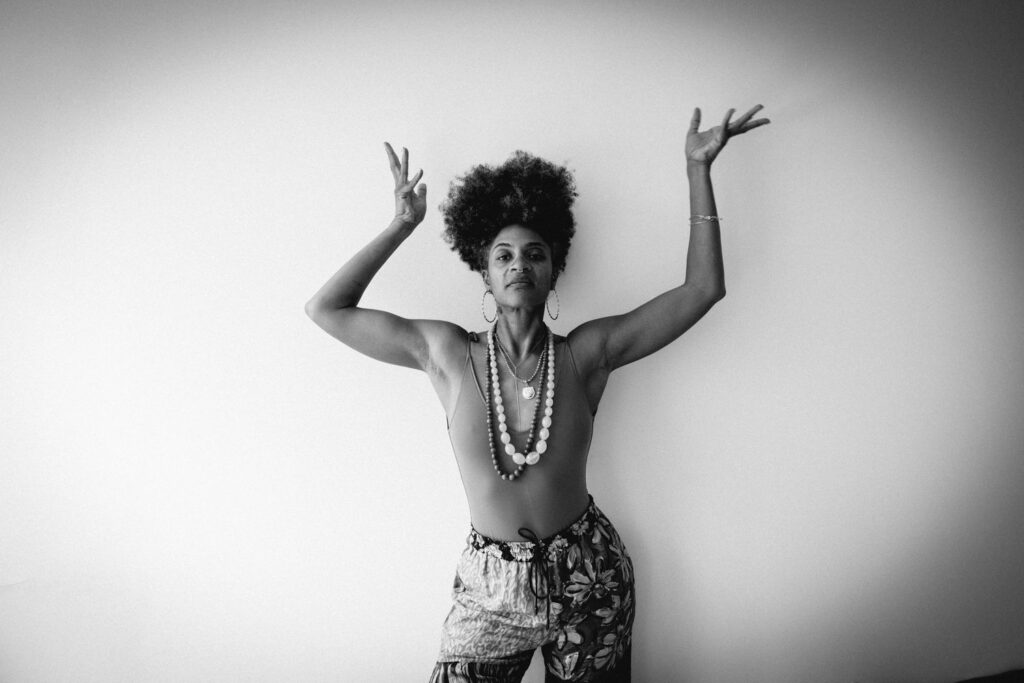Le numérique facilite-t-il la lutte contre les inégalités de genre ou les renforce-t-il ? Quel pouvoir avons-nous en tant que citoyennes pour le façonner à notre image et le rendre plus inclusif ? Nous avons posé ces questions et bien d’autres, à deux spécialistes : la journaliste Mathilde Saliou qui a publié l’essai Technoféminisme (Grasset, 2023) et la référente numérique responsable d’un grand groupe bancaire et administratrice des fameuses, Lucile Vannier. Leur crédo commun : sensibilisons-nous, donnons-notre avis, engageons-nous !
Pouvez-vous chacune vous présenter, et nous dire comment vous avez croisé les questions féministes ?
Mathilde Saliou : Sur le plan personnel, je suis entrée en féminisme pendant ma césure au Mexique, en partageant les réflexions d’une amie qui travaillait là-bas sur les féminicides (ndlr : le Mexique est un des pays au monde où ils sont les plus nombreux). Je me suis rendu compte de l’aspect systémique de la question et de l’urgence de l’adresser. Sur le plan professionnel, je dois dire que j’avais vraiment la flemme d’entrer sur un marché de l’emploi où je serai payée un quart de moins que les hommes. J’ai croisé le chemin d’associations qui militaient sur le sujet, d’abord à Sciences Po où j’ai fait mes études, et puis chez « Prenons la Une » (ndlr : association de femmes journalistes qui militent depuis 2014 pour une juste représentation des femmes dans les médias et l’égalité dans les rédactions), dont je suis devenue adhérente en même temps que je commençais à travailler.
Lucile Vannier : Je suis entrée en féminisme par hasard. Un de mes anciens chefs m’a proposé d’entrer dans un parcours « Talents féminins », ce qui m’a d’abord beaucoup contrariée : moi, je voulais suivre le parcours « Talents » tout court. Finalement, j’ai pris conscience pendant ce programme des stéréotypes, des biais, des inégalités structurelles, et j’ai eu envie que tout le monde le sache aussi. Je ne crois pas que mon responsable avait conscience que je deviendrais féministe à ce point ! (rires)
« J’adore trainer en ligne, et malgré cela il m’arrive d’avoir peur », écrivez-vous dans « Technoféminisme », Mathilde. Quels liens entretenez-vous chacune avec le web / l’internet / la tech / le numérique ?
L. V. : Je ne suis pas une gameuse mais je suis considérée comme une geek par des gens qui m’entourent. Je ne crois pas que je me qualifierais comme cela dans les usages mais c’est vrai que les enjeux autour de la Tech et de l’innovation m’intéressent depuis longtemps. J’en avais d’ailleurs fait une spécialisation dans mon école d’ingénieur·es. J’ai commencé à travailler sur le numérique en passant par la biométrie, à l’époque je trouvais ça génial : aujourd’hui je vois qu’on tue avec la reconnaissance faciale et je me sens vraiment triste d’avoir participé à ça. Le web me semble être un endroit génial, mais il me fait aussi très peur, dans sa façon d’alimenter la haine.
M. S. : J’adore être en ligne parce que la sérendipité, le fait de naviguer de données en données, me permet d’apprendre énormément en permanence. Mais par exemple, quand j’ai sorti mon livre, je me suis un peu inquiétée de savoir ce qu’il se passerait s’il circulait dans des communautés anti-féministes. Je pense être armée pour l’affronter car je travaille sur les cyberviolences et la sécurité numérique, ce qui me permet d’avoir quelques réflexes de base en la matière, mais c’est symptomatique de l’ambivalence du numérique, notamment pour les femmes et les minorités : c’est génial et risqué à la fois.
De fait, les femmes sont 27 fois plus susceptibles d’être victimes de harcèlement ou de discours de haine en ligne, selon les Nations Unies. Pourquoi ?
L. V. : C’est un prolongement et une accentuation d’un phénomène qu’on retrouve dans la réalité : quand les femmes ou les filles prennent la parole dans l’espace public, il y a souvent quelqu’un pour leur dire de se taire ou de faire moins de bruit. Ces violences sont faites pour nous invisibiliser et nous envoyer le message que nous ne sommes pas les bienvenues dans ces espaces. C’est pour ça qu’il faut continuer de prendre la parole et, en parallèle, en finir avec cette impunité en ligne. D’autant que les conséquences des violences sur la santé mentale ne s’arrêtent pas quand les écrans sont éteints.
Mathilde, vous disiez avoir des « réflexes de base » pour y faire face, que recommandez-vous ?
M. S. : Je dirais par exemple que c’est parfaitement « ok » de bloquer des gens pour protéger sa bulle numérique. Je préconiserais aussi de se renseigner sur ses paramètres pour aller trouver la meilleure manière d’envoyer des signalements, même si cette capacité a été réduite et modifié depuis le début de l’année. Je recommanderais aussi la plateforme Pharos, qui est une plateforme gouvernementale de signalements des comportements et contenus en ligne (elle manque de moyens mais elle existe…). Et je prendrais des captures d’écran des violences, ou, si je n’étais pas en état, je demanderais à un proche de le faire pour moi.
Ce que l’on observe c’est que le numérique a surgi dans nos vies depuis peu de temps à l’échelle de l’humanité, et que nous manquons de formation/sensibilisation sur tous les enjeux qu’il englobe, non ?
L. V. : Alors je nuancerais. On ne peut pas dire qu’on manque de rapports et de préconisations. Je dirais que ce qui manque c’est plutôt de la volonté politique pour mettre en œuvre ces actions.
M. S. : L’éducation aux médias et au numérique existe, mais je n’ai pas de chiffre sur combien d’écoles la mettent en œuvre, et je pense que s’ils existaient ils ne seraient pas très élevés. L’idéal je trouve serait de faire des ponts entre l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) qui va peut-être enfin être dispensée dans les écoles alors que la loi la rend obligatoire depuis 2001, et l’éducation aux médias. Je m’explique : aujourd’hui, on se drague à distance, on se date* à distance. Je rejoins Lucile sur le fait qu’on manque d’une pensée systémique au niveau gouvernemental. Par exemple, un grand plan sur l’Intelligence artificielle est lancée, pour rattraper la Chine et les Etats-Unis (ce qui n’arrivera jamais), sans que les objectifs soient questionnés. Pourquoi suivre les Etats-Unis et la Chine ? L’argent investi dans l’IA ne serait-il pas plus utile à investir dans l’éducation et la prévention ? Toutes ces décisions sont politiques. Ce sont des choix. Sommes-nous d’accord avec ces choix ?
En quoi les savoirs féministes sont-ils des outils très utiles pour comprendre ce qui bug en matière de numérique mais aussi pour nous aider à imaginer un autre fonctionnement ?
M. S. : Ils sont très utiles dans leur critique des logiques de rationalité. Dans le numérique, il y a l’idée que comme ça passe par les mathématiques, c’est forcément rationnel et neutre, mais pas du tout ! Les outils numériques sont construits par des êtres humains, souvent des hommes, sur la base de données triées, compilées, traitées, majoritairement par des hommes, blancs, occidentaux : ce n’est pas sans impact sur ce que deviennent ces outils ! J’ajouterais que la numérisation de nos pratiques ont un impact environnemental et social catastrophiques, j’en parlerai dans mon prochain livre. Par exemple, la République démocratique du Congo est une économie militarisée depuis 30 ans, un terrain de viols de guerre massif : c’est lié à l’extraction qui en est fait des terres rares qui font tourner l’économie numérique, qui elle-même permet de faire tourner plus fort l’économie du pétrole.
L. V. : C’est important de rappeler que tous les biais dont nous parlons sont ceux qui existent dans le monde réel, mais qu’ils y sont amplifiés et renforcés. Les pensées féministes et les militantes permettent de comprendre et de donner des clés pour les combattre. Parce que pour ma part, je suis convaincue que l’on peut encore construire un numérique beaucoup plus beau, inclusif, en diversifiant et en féminisant les gens qui le construisent.
Quel est votre regard sur les intelligences artificielles, notamment en matière de sexisme et autres oppressions systémiques ?
M. S. : Il faut bien comprendre que les IA sont entrainées sur la base des données disponibles sur le web mondial. Or, en fonction des zones géographiques, les populations ne sont pas représentées de la même manière. En l’occurrence, les personnes qui génèrent le plus de data (ndlr : données) sont plutôt des personnes de type masculin, blanches, qui habitent dans les pays occidentaux. Conclusion, si on demande à une IA de trouver une représentation de « CEO » (ndlr : chief executive officer, c’est-à-dire un dirigeant) en anglais, la machine n’imagine pas autre chose qu’un homme blanc en costard cravate. Idem quand on passe d’une langue neutre à une langue genrée, du français à l’anglais par exemple : « doctor » devient systématiquement masculin, « docteur », mais à l’inverse, « nurse » passe au féminin, « infirmière ». Cela tient à la sociologie de ces professions et aux données disponibles à ce sujet, mais pas seulement, c’est aussi la conséquence de l’entrainement des IA par des personnes pas assez diversifiées. Plus grave, ces représentations biaisées se retrouvent aussi au sein des technologies de reconnaissance d’images, vendues à des industries de la défense et sécurité. Par exemple, aux Etats-Unis, il a été démontré que des logiciels utilisés par la police au travers de la vidéosurveillance avaient conduit à des emprisonnements d’hommes noirs, par erreur. Et les cas qu’on connait sont ceux des personnes qui avaient suffisamment de moyens pour se défendre et sortir…
L. V. : Je ne suis pas du tout favorable à une démocratisation de l’IA, qui requière énormément de ressources (énergies fossiles, minerais, eau..), et qui renforcent tous les stéréotypes. Aujourd’hui, le seul marché qui est rentable pour l’IA, c’est celui de l’armée. Ca devrait vraiment nous inquiéter. Utilisons-la quand c’est utile. J’ai décidé, personnellement, que je ne l’utiliserais pas, j’espère que je pourrai tenir.
A l’échelle individuelle, tout cela peut sembler un peu écrasant : quel type d’actions pouvons-nous engager ? Qu’est-ce qui est en notre pouvoir pour réorienter la manière dont le web est conçu ?
M. S. : Déjà, c’est important de rappeler qu’être compétent du point de de vue du numérique ne se résume pas à coder. Ça peut être aussi réaliser un montage vidéo, gérer des groupes de discussions, ou réguler son temps d’utilisation des outils. C’est ce que je teste en ce moment : limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Souvenons-nous que leurs propriétaires ont tout intérêt à être perçus comme des monstres inattaquables, ou au contraire des infrastructures qu’on oublie. Tout ce qui vise à les remettre en question, ou à échapper à leur emprise (par exemple en réduisant notre présence dans leurs outils) est contraire à leurs intérêts. Mais je crois aussi beaucoup à la démocratie locale pour nous organiser : se réunir avec des parents d’élèves pour décider de règles communes dans les écoles, demander de la transparence à votre commune au sujet des outils utilisés. Le numérique est un outil politique, déneutralisons-le, mettons ses usages en débat, de manière collective.
L. V. : J’agis au quotidien au sein de mon entreprise sur le numérique responsable pour pousser à davantage d’écoconception et d’accessibilité. Et je crois vraiment à la transmission de compétences, à l’éducation pour favoriser les prises de conscience. Voilà pourquoi je suis aussi animatrice de fresques du climat, du numérique et de la bataille de l’IA. J’invite chacune et chacun à les découvrir pour aiguiser son esprit critique sur ces sujets. J’ai aussi créé un jeu, je suis disponible pour le faire découvrir. Pour terminer, de mon point de vue ce serait bien qu’on arrête de penser que le numérique va nous sauver de tous nos maux, alors que ce n’est pas le cas. Nous avons du pouvoir là-dessus.
Rédaction : Clémence Leveau
* dater provient de l’anglais « to date » qui signifie sortir avec quelqu’un·e