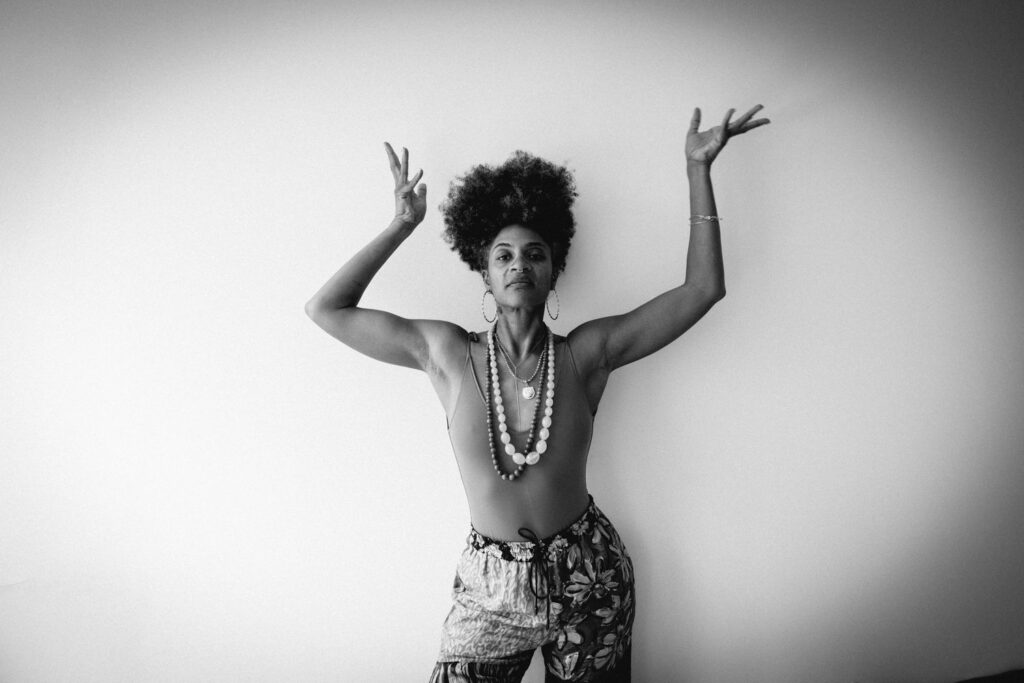Voilà un terrain de jeu immense pour repenser notre monde et notre lutte : la famille, la filiation, la parentalité. En s’intéressant aux parentalités féministes, indubitablement liées, comme l’explique le collectif Front de mères, aux enjeux écologistes et antiracistes, on entre dans la matrice de nos sociétés hétéropatriarcales. Tania Cadre, administratrice des fameuses, membre du PA.F (pour Parentalité féministe), et Priscilla Zamord, déléguée générale du syndicat de parents Front de mères France, ne s’y sont pas trompées et abordent, chacune à leur manière, la mère, comme sujet politique.
Pouvez-vous vous présenter ?
Tania Cadre : Je m’appelle Tania Cadre, je suis membre du PA.F depuis deux ans, un collectif féministe composé de parents, et de l’association les fameuses depuis un an. Je suis aussi responsable de projet immobilier chez un bailleur social et maman de deux enfants en garde partagée.
Priscilla Zamord : Depuis 2021, je suis déléguée du Front de mères, un syndicat de parents. J’y suis salariée depuis 2024 et je suis basée à Rennes. J’ai un enfant ! J’insiste sur le terme de syndicat, car nous avons une posture de défense des parents des quartiers populaires. On étudie les dossiers, on accompagne les parents et on fait des plaidoyers.
C’est quoi, pour vous, la parentalité féministe ?
T.C : La parentalité féministe combine pour moi l’éducation non-sexiste, la lutte contre les stéréotypes et la parentalité égalitaire.
P.Z : La parentalité telle qu’on l’aborde au Front de mères est au carrefour de trois enjeux : la question du féminisme, de l’antiracisme et de l’écologie. On essaie de porter un plaidoyer sur l’intersectionnalité de ces trois sujets. Les uns ne vont pas sans les autres, car on n’est pas femme le lundi, victime du réchauffement climatique le mardi et noire le mercredi. Les mamans des quartiers populaires sont victimes de discriminations qui se croisent et, dans la loi, quand on dépose une plainte pour discrimination, on doit choisir un critère ; on ne peut pas avoir les trois. On milite justement pour qu’une autre approche existe.
La question du féminisme se pose pour nous aussi dans la transmission des luttes et la valorisation de nos mères qui ont pu être disqualifiées, invisibilisées, dévalorisées, sommées d’être des mères tampon pour garder leurs enfants à la maison afin qu’ils n’aillent surtout pas dans l’espace public. Elles étaient invitées à faire des gâteaux, des loukoums et des couscous pour la fête de l’école, mais absolument pas considérées comme des sujets politiques.
Notre idée, c’est plutôt de renverser la table, de valoriser leurs luttes qu’elles soient individuelles ou collectives et se réapproprier l’histoire de nos mères. On a un matrimoine de lutte antiraciste, antisexiste en France qui est complètement passé à la trappe, alors qu’il existe. Nos mères, en France, ont été plutôt marginalisées des mouvements féministes blancs CSP+ traditionnels.
Les choses sont-elles plus poreuses aujourd’hui ?
P.Z : L’auto-organisation de femmes sur les questions d’intersectionnalité fait qu’on est beaucoup plus puissantes et visibles aujourd’hui. Il y a un véritable écosystème avec des personnes représentées dans les médias. Les choses évoluent, mais c’est aussi parce qu’il y a eu, à un moment, dans les mouvements féministes, une obligation à se poser des questions. Les mouvements féministes reproduisaient un système de domination vis-à-vis des personnes racisées issues de l’immigration post-coloniale. Donc à un moment, on met les gens face à leurs incohérences et on essaie de se questionner. Fort heureusement, il y a des gens assez intelligents pour essayer de se déconstruire.
Vous avez toutes les deux décidé de vous engager sur cette question de la parentalité, de la lutte contre les discriminations que subissent les enfants. Pourquoi ces causes-là précisément ?
P.Z : J’ai atterri au Front de mères sans être maman, mais j’en avais déjà le projet. J’ai lu le livre de Fatima Ouassak (fondatrice du Front de mères dans le 93), La puissance des mères (Ed. La Découverte), et j’ai eu un électrochoc. Le même électrochoc qu’à ma découverte d’Aimé Césaire ou d’Édouard Glissant. C’était la première fois que je lisais un essai politique, un manifeste, qui partait du terrain et qui faisait état d’entraves que j’avais moi-même pu vivre à différents endroits.
Et il y avait cette question des enfants. J’ai été choquée par la violence avec laquelle la proposition de Fatima Ouassak d’instaurer des repas végétariens à la cantine a été reçue par la FCPE. Elle arrive avec une proposition écologique mais est “accueillie” comme femme racisée et musulmane et se tape un torrent de boue islamophobe, raciste et sexiste. Ça m’a frappée.
Puis est arrivée ma grossesse, la naissance de ma fille et son lot de questions sur le sexisme, le racisme et la LGBTphobie dont nous pouvions être la cible. J’avais déjà été militante, mais sans forcément adhérer à un mouvement. Là, j’ai voulu sauter le pas car c’est un espace militant au carrefour de plusieurs sujets fondamentaux. Et il y a urgence, en fait ! Nos gamins meurent. Ils se font tuer par la police, ils ont un avenir morose avec le réchauffement climatique et la montée de l’extrême droite.
T.C : Je viens d’une famille modeste, j’ai vécu mon enfance dans un quartier défavorisé et pour le coup j’ai très vite eu conscience des inégalités sociales et par extension des inégalités en général. C’est quelque chose qui m’a toujours habitée. Une fois étudiante, j’ai entamé des études scientifiques et j’ai constaté les stéréotypes qui pèsent sur les femmes dans le milieu des sciences. J’ai été diplômée en 2001 d’une école d’ingénieur·e comprenant 15 à 20 % de femmes. J’étais persuadée que vingt ans plus tard, les choses auraient changé, mais je me suis trompée, les chiffres sont les mêmes, voire un peu inférieurs.
Tout ça nourrissait chez moi une grande incompréhension que je ne théorisais pas trop. Puis, je suis devenue maman et je me souviens avoir lu sur le blog de la Bédéiste d’Emma la planche Fallait demander (par la suite intégrée à la BD Un autre regard 2). Cela a mis des mots (et des dessins…) sur ce que je ressentais confusément : le poids de la charge mentale. Ce fut donc ma porte d’entrée dans le féminisme. J’ai le sentiment, via la parentalité, de pouvoir agir à mon niveau sur cette question du féminisme.
Le Front de mères, comme le PA.F, sont basés sur le collectif. Priscilla, je vous ai même entendu dire que le collectif réparait. Alors, pour vous deux, pourquoi ce collectif répare-t-il justement ? Et qu’est-ce qu’il permet ?
P.Z : Je vais dire des choses assez basiques, mais le collectif permet déjà de ne pas se sentir seule dans ce qu’on a vécu individuellement. Et ça nous donne de la force face à la brutalité de la politique nationale et internationale. Le collectif permet de déposer, de se soutenir d’un point de vue santé mentale et physique. On est dans une période de criminalisation importante des militants de l’égalité, de l’écologie. Se retrouver dans un espace safe, c’est vital.
Et puis, il y a la question pratico-pratique de l’entraide et de l’idée de se créer des espaces de répit. Que ce soit pour les mères en charge d’un enfant en situation de handicap ou pour les mères solos, ces enjeux de répit ne sont pas suffisamment pensés. J’hallucine de constater à quel point on réussit à rester debout.
Il faut aussi absolument conserver notre joie militante et ça, ça passe bien sûr par le collectif. Goundo Diawara a publié un texte dans le dernier numéro de La Déferlante qui est très important, je pense. Elle y parle justement de l’amour pour nos enfants, pour nous-mêmes et notre quartier. On doit célébrer cet amour et célébrer nos victoires.
C’est quoi votre dernière victoire ?
P.Z : Dans le quartier de Maurepas à Rennes, le quartier le plus pauvre de Bretagne, il y a beaucoup de violence liée au narcotrafic. Récemment, un enfant de cinq ans a reçu deux balles perdues dans la tête. Il n’est pas mort mais gardera de graves séquelles. Une avalanche de médias sont arrivés avec des postures et des discours hyper problématiques. Mais on a réussi, collectivement, à se rassembler et à écrire une tribune. Ça semble anecdotique, mais dans ce contexte, avec les habitant·es comme les professionnel·les en état de choc, on n’a rien lâché.
La tribune a été reprise par Mediapart, un article a été publié dans Streetpress. Ça nous a fait du bien de voir qu’on avait une audience, une visibilité non déformée.
Et pour vous Tania ? Quelle place prend le collectif ?
T.C : Je rejoins ce que dit Priscilla sur la question de la réparation. Le collectif permet de ne pas être seule avec ses questions et de trouver des réponses. Dans le contexte politique actuel, on peut parfois douter de nos croyances. Il est important de se retrouver et d’échanger sans devoir se justifier en permanence de ses opinions.
P.Z : Oui, je partage cette idée et j’ajoute que ces échanges permettent aussi de partager nos expertises et de construire des solutions. Et j’ai envie d’insister sur cette question du temps qu’on réfléchit ensemble. Car le gouvernement nous lâche des dingueries toutes les cinq minutes et on ne peut pas tout le temps être dans la réaction. On doit reprendre le contrôle du temps en cherchant à savoir ce qui nous fait du bien, à nous et aux autres, pour déployer une stratégie, la réfléchir et ne pas se faire braquer notre agenda politique par des personnes extérieures.
T.C : C’est aussi de la stratégie de leur part que de saturer l’espace médiatique !
P.Z : Absolument ! Et le collectif répare aussi sur des sujets internationaux. Ce qui se passe en Palestine et au Congo nous mobilise beaucoup au sein du Front de mères. Avoir des espaces pour se dire « est-ce normal que personne n’en parle et que ce soit banalisé ? », c’est aussi se rassurer.
Où comptez-vous mettre prioritairement votre énergie dans les mois à venir ?
PZ : Cette année, nous allons mettre l’accent sur la défense des droits des enfants pour un environnement sain. Nous nous appuyons aussi sur le dernier rapport de la rapporteuse des droits sur ce sujet. Derrière le mot « environnement », il est question d’écologie, mais pas seulement. C’est aussi une question sociale et culturelle.
Nous allons également insister sur nos actions d’autoformation. Localement, par exemple à Rennes, nous déployons deux programmes : Les dingueries de la Terre, un parcours d’écologie antiraciste. C’est la troisième édition, qui se déroulera de mars à juillet.
Nous avons aussi un autre programme de formation pour les parents délégués. Nous nous demandons comment être formés, en tant que parents, si l’extrême droite arrive demain au pouvoir. Comment éviter que notre parole et notre représentation soient confisquées par une sociologie de parents qui ne nous représente pas ? Nous voulons plus de sujets sur la diversité, l’égalité et l’écologie dans l’Éducation nationale.
TC : Moi, mon cheval de bataille, c’est déjà de continuer à m’engager et à être dans l’action, de ne pas sombrer dans la résignation. J’espère conserver ma capacité d’indignation, car c’est un peu décourageant ce que l’on voit.
Vous, Tania, vous parlez en tant que cheffe de famille monoparentale. C’est un sujet qui prend doucement sa place dans le débat public. Ça vous semble aller dans le bon sens ?
TC : C’est quelque chose dont on parle au sein du PAf (cf la tribune du Monde d’octobre 2023). Cela prend sa place dans le débat public et tant mieux car, avec 1 famille sur 4 en monoparentalité, c’est un véritable sujet de société. Et c’est un sujet qui recoupe plusieurs problématiques à la fois politiques et sociétales.
13 % des enfants de parents séparés sont en garde partagée type 50/50, 83 % sont en résidence principale chez leur mère et 4 % chez leur père. Dans 80 % des cas de séparation, il y a consensus, le choix du mode de garde n’est pas imposé. Ces chiffres traduisent bien les conséquences d’une parentalité qui n’est toujours pas égalitaire. Cela fragilise les femmes sur tous les points de vue et notamment financier. Que le sujet entre dans le débat public, qu’il fasse l’objet de différentes missions parlementaires va dans le bon sens mais ce qu’il faut surtout ce sont des actes, des décisions politiques.
PZ : De notre côté, nous nous penchons pas mal sur les violences économiques post-séparation, sur les pensions alimentaires et la vie quotidienne. Et toujours cette question du répit qui revient. Même pour les familles en garde partagée, la semaine de répit n’en est pas une. Cela m’amène à parler de la fête comme sujet politique, et de la vie affective et sexuelle des mères. Où est-ce qu’on danse ? Où est-ce qu’on rencontre ?
La société va très mal et culturellement, il y a aussi une domination du rock et de l’électro. Même si cela nous plaît, nous avons aussi envie d’avoir des soirées avec des musiques qui nous représentent. Où sont les sons afro-caribéens, antillais, africains ? Les soirées hip-hop ? Nous n’avons pas cette diversité, et cela ne nous donne pas envie de sortir.
La fête est politique, c’est important de le dire. Et elle va de plus en plus devenir un espace de résistance. Parce que l’idée, c’est de diviser et que les gens restent chez eux, devant leurs écrans.
TC : Ça rejoint ce que je disais : être dans l’action pour ne pas se résigner, car c’est facile aujourd’hui de se résigner et de rester chez soi devant Netflix, c’est open bar !
Par quoi commence-t-on alors pour lutter contre l’extrême droite ? Cela passe par ça ? Sortir ? Être dans l’échange ? Faire la fête ? Essayer de créer des espaces collectifs ?
PZ : Il faut absolument rejoindre une association, un syndicat, un collectif, ne pas rester seul·e.
TC : Je pense que certaines personnes ont une difficulté à s’engager, car elles ne se sentent pas forcément légitimes. Pour moi, par exemple, faire cette démarche fut difficile, car je ne me sentais pas experte, pas légitime, même si le sujet m’intéressait énormément. Il est important de lever ce frein à l’engagement. Je me demande comment agir sur cette résistance que l’on peut avoir.
PZ : Il faut aussi revoir les modalités d’engagement. Nous avons une vision du bénévolat qui nécessiterait forcément d’être à la retraite avec un temps plein à disposition. Il y a des solidarités informelles qui peuvent se créer en temps de crise, nous l’avons vu cet été. Mais nous pouvons aussi poser les règles du jeu et dire « voici ce que je peux proposer », et savoir que la personne s’engage sur ce volet-là. Il faut déconstruire cette idée du bénévolat sans limites dans lequel on a tendance à se cramer. L’idée, ici, c’est de faire du durable. Nous pouvons donner peu de temps, mais de manière qualitative et dans la durée. Et bien sûr, systématiser la garde d’enfants durant nos événements.
Rédactrice : Valérie Gautier