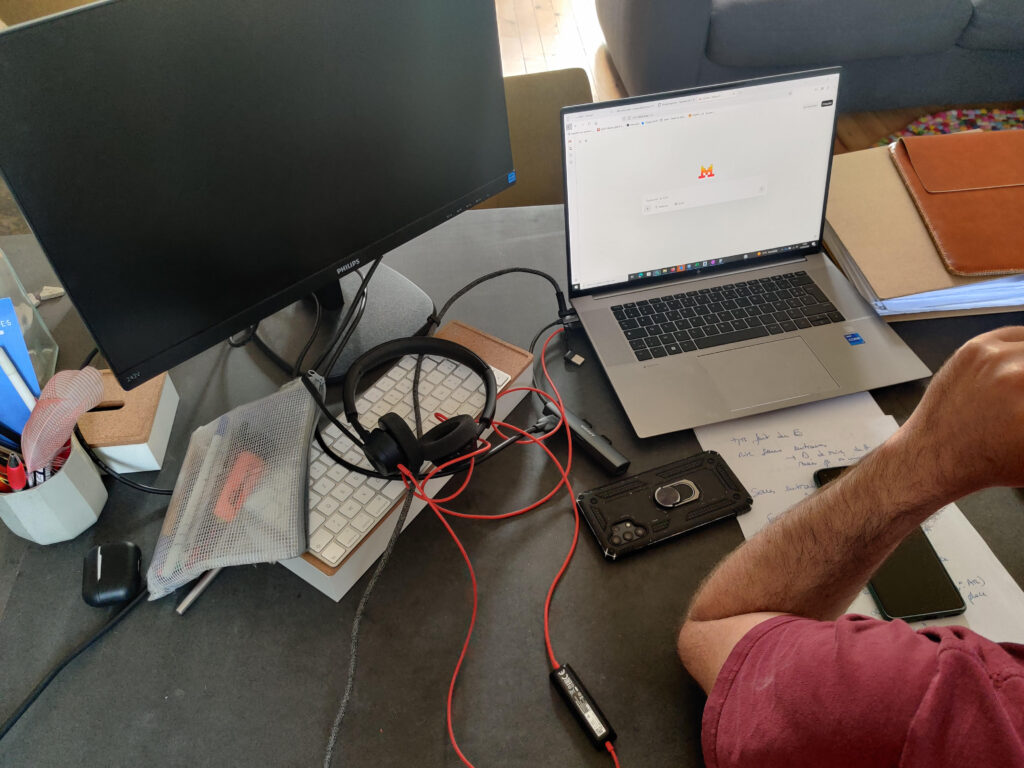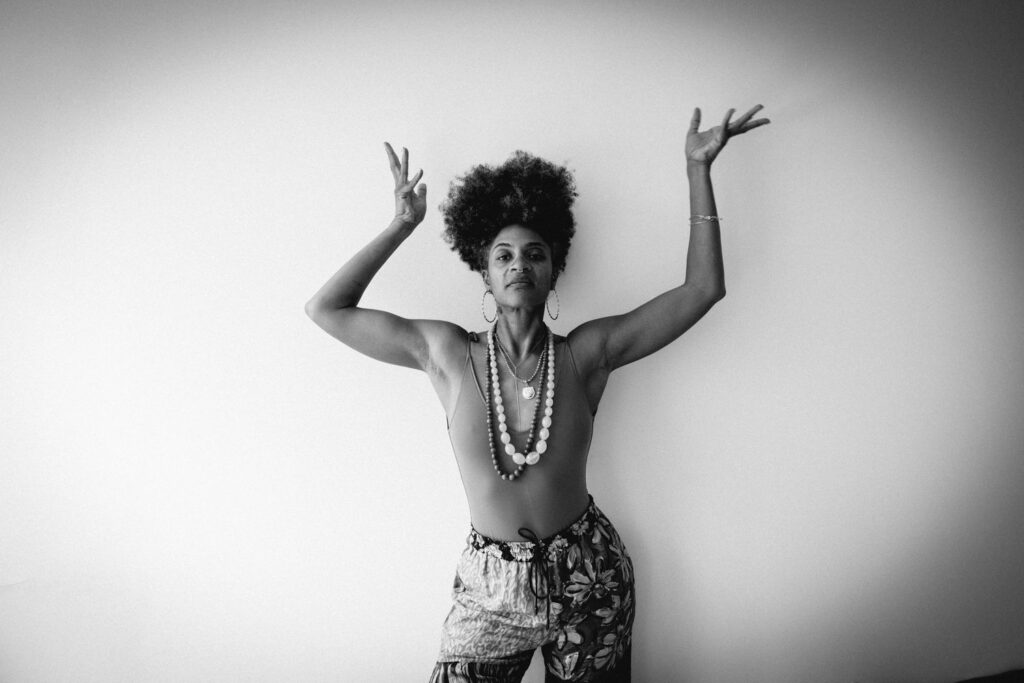L’intelligence artificielle générative (Chat GPT, Le Chat…) a fait irruption dans nos vies…et sur les bancs de l’école et des universités. Impact environnemental, biais, exactitude des informations : les questions qu’elle pose sont nombreuses, sans que les enseignantes aient toujours le temps ni les outils pour y répondre. Trois d’entre elles, en poste à Nantes auprès de différents publics (collège, lycée, université), ont accepté de nous partager leur regard sur l’impact de ce nouvel outil.
Selon Mathilde Julla-Marcy, enseignante-chercheuse en sociologie à l’UFR STAPS de Nantes Université, l’IA générative (comme Chat GPT) “soulève des questions d’ordre éthique et politique”, ne serait-ce que par le fait qu’il s’agit d’un “outil développé par et pour des intérêts privés et marchands”. Si le plagiat est réglementé, “l’usage de l’IA relève pour l’instant d’un vide juridique”. Du questionnaire anonymisé qu’elle a soumis à ses 25 étudiant·es, dont 4 femmes, sur leurs usages et représentations de l’IA, il ressort qu’ils en font tous un usage “massif et régulier”. Les résultats de la récente étude de cas qu’elle leur a soumis mettent en évidence une “homogénéisation de la pensée, un manque de réflexion personnelle”. Selon elle, il reste des étapes indispensables à franchir pour que l’usage de l’IA soit “pertinent et responsable”, et surtout une pédagogie à faire sur ses enjeux, sur son impact environnemental, sur la reproduction de stéréotypes de genre par les biais nichés dans les bases de données.
Ingénieure informatique, Lucie enseigne la technologie depuis 4 ans à des élèves de collège. Elle mesure la responsabilité qu’elle a de devoir composer avec cet outil “utile et puissant”. Or, il n’y a “pas vraiment de directives officielles” pour savoir comment l’introduire dans les cours. Une charte serait en préparation. La conférence sur l’IA donnée l’an passé aux profs de son établissement a reçu un “accueil mitigé, voire froid”. Elle sait que ses élèves utilisent l’IA, sans distinction de genre, mais “ils n’osent pas le dire”. Oui, la pédagogie de Lucie est impactée par l’IA ; cela ne l’inquiète pas, “ça nous sort de notre zone de confort, nous les profs”, mais selon elle, “avec ou sans l’IA, l’apprentissage n’est pas différent”.
Pour Ophélie, prof d’anglais en lycée, l’IA générative a bel et bien fait irruption en classe. Les élèves l’utilisent comme par “réflexe”. De facto, son enseignement s’en trouve affecté : “on se retrouve comme obligé de l’utiliser”, tant et si bien qu’elle ne donne plus de devoirs à faire à la maison car elle n’a “plus confiance”. Exemple d’un travail de groupe donné aux Terminales ; sans aucune réflexion collective préalable, ils ont immédiatement lancé ChatGPT. “L’IA est une entrave à la réflexion”, dit-elle. Certes, pour elle, en tant que prof, l’IA peut être une aide précieuse et un gain de temps pour préparer les cours et pour les élèves, un moyen facilement mobilisable pour améliorer leurs compétences, par exemple sur des points précis de grammaire. Elle sait que les élèves sont conscients des enjeux liés à l’utilisation massive de l’IA, mais qu’ils vont néanmoins “au plus simple”. “Profs, élèves, établissements, parents, nous sommes tous concernés par l’IA à l’école, mais ça nous dépasse un peu”.
Très largement adoptée par les jeunes, l’utilisation de l’IA générative pourrait être conçue comme un formidable outil pour stimuler les apprentissages. Or, la culture du numérique étant encore loin d’être acquise, un grand flou et des inquiétudes dominent encore.
Rédaction : Florence Lesavre